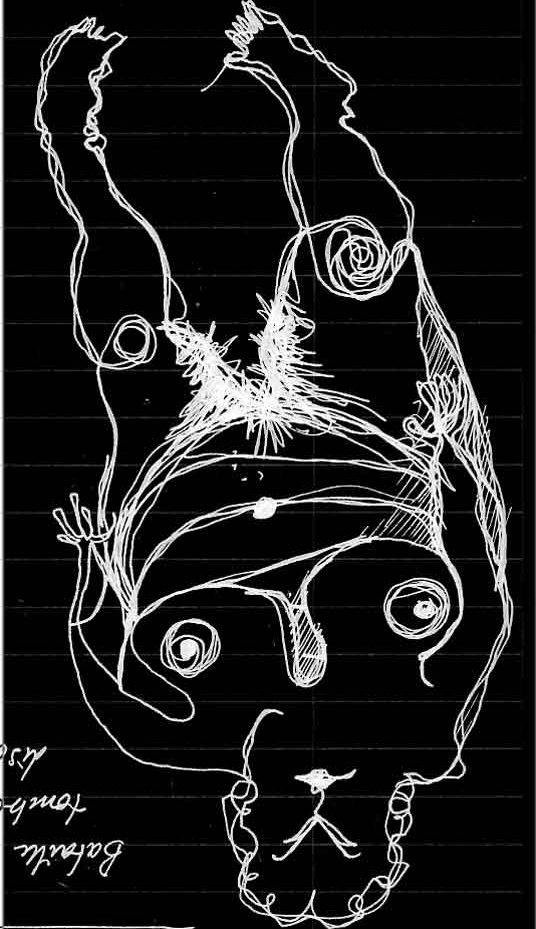OLGA OROZCO écrit ces ça là…
GENÈSE
« Il n’y avait aucun signe sur la peau du temps.
Rien. Ni ce tapis d’hiver soudain qui présage les griffes de l’éclair peut-être jusqu’à [demain.
Ni ces incendies depuis toujours qui annoncent une torche entre les eaux de tout l’avenir.
Ni même le frisson de l’avertissement sous un souffle d’abîme qui débouche sur jamais [ ou sur hier.
Rien. Ni terre promise.
C’était seulement un désert de chaux vive aussi blanche que noire,
un avide fantôme né des pierres pour ronger le rêve millénaire,
la chute vers le dehors qui est le rêve dont rêve les pierres.
Personne. Seulement un écho de pas sans personne qui s’éloignent
et un lit replié sur lui-même en marche vers la fin.
Moi j’étais là étendue;
moi, avec les yeux ouverts.
J’avais dans chaque main une caverne pour regarder Dieu,
et une traînée de fourmis allait de son ombre jusqu’à mon cœur et ma tête.
Et quelqu’un a brisé en haut cette jarre grise où
montaient boire les souvenirs;
ensuite il a brisé le memorandum d’aveugles serments blessés traîtreusement
et il a détruit les tables de la loi inscrites avec le sang coagulé des histoires mortes.
Quelqu’un a fait un brasier et a jeté un à un les fragments.
Le ciel brûlait dans l’extinction de tous les enfers
et sur la terre s’effaçaient ses traces et ses preuves.
Moi j’étais suspendue dans un temps de l’expiation
sacrée;
moi j’étais d’un côté très lucide de Dieu;
moi, avec les yeux fermés.
Alors, ils ont prononcé la parole.
Il y eut une clameur de vert paradis qui monte en déchirant la racine de la pierre,
et sa proue céleste a avancé entre la lumière et les ténèbres.
Ils ont ouvert les vannes.
Une eau radiante a comblé le creux de toute l’espérance encore inhabitée,
et les eaux avaient jusqu’en haut cette couleur de miroir dans lequel personne ne s’est [jamais regardé,
et vers le bas un éclat de grotte orageuse qui regarde depuis toujours pour la première
[fois.
Ils ont dévoilé soudain les marées.
Derrière a surgi une terre pour marquer au feu chaque pas du destin,
pour envelopper en herbe assoiffée le chute et le revers de chaque naissance,
pour enfermer de nouveau dans chaque cœur l’amande du mystère.
Ils ont levé les scellés.
La cage du grand jour a ouvert ses portes au délire du soleil
tant que toute nouvelle captivité du temps sera éblouissement dans le regard,
pourvu que chaque nuit tombe avec le voile de la révélation aux pieds de la lune.
Ils ont semé dans les eaux et dans les vents.
Et depuis ce moment il y a eu un bord de plumes allumées depuis le lointain le plus éloigné,
des ailes qui viennent et s’en vont en un vol d’adieu à tous les adieux.
Ils ont insufflé un souffle dans les entrailles de toute l’extension.
Ce fut un effleurement contre l’ultime fond du sang;
ce fut un frémissement d’étamines dans le vertige de l’air;
et l’âme est descendue à la lumineuse terre glaise pour combler la forme semblable à son image,
et la chair s’est élevée comme un chiffre exact,
comme la différence promise entre le début et la fin.
Alors s’accompliront l’après-midi et le matin
dans le dernier jour des siècles.
Moi j’étais face à toi;
moi, avec les yeux ouverts sous tes yeux
dans l’aube première de l’oubli. »
![]() Miguel Oscar Menassa récitant Olga Orozco
Miguel Oscar Menassa récitant Olga Orozco
&
VARIATIONS SUR LE TEMPS
« Temps:
tu t’es revêtu de la
peau rongée du dernier prophète;
tu as usé ta figure jusqu’à l’extrême pâleur;
tu t’es mis une couronne faite de miroirs brisés et de pluvieux lambeaux,
et tu psalmodies maintenant le balbutiement de l’avenir avec les mélodies déterrées d’autrefois,
tandis que tu erres en ombres dans ton escurial affamé, comme les rois fous.
Tes folies de fantôme inconclus ne m’importe déjà plus,
misérable amphitryon .
Tu peux ronger les os des grandes promesses dans leurs catafalques évanouis
ou goûter l’âpre breuvage que répandent les décapitations.
Et ce n’est pas encore tout
jusqu’à ce que tu ne dévores avec ta cour goyesque la mouture finale.
Jamais nos pas ne se sont rythmés dans ses labyrinthes entrecroisés.
Ni même au commencement,
quand tu me conduisais par la main dans le bois enchanté
et tu m’obligeais à courir à bout de souffle derrière cette tour hors d’atteinte
ou à découvrir toujours la même amande avec son obscure saveur de peur et d’innocence.
Ah! ton plumage bleu brillant entre les branches!
Je n’ai pas pu t’embaumer et n’ai pas réussi à extraire ton cœur comme une pomme d’or.
Trop bousculant ,
tu as été ensuite le fouet qui excite,
le cocher impérial me piétinant sous les pattes de ses bêtes
Trop bousculant .
Tu m’as condamné à être l’otage ignoré,
la victime ensevelie jusqu’aux épaules dans des siècles de sable.
Nous avons lutté parfois corps à corps.
Nous nous sommes disputés comme des bêtes sauvages chaque portion d’amour,
chaque pacte signé avec l’encre que tu forges dans quelque éternité instantanée.
Chaque visage sculpté dans l’inconstance des nuages voyageurs,
chaque maison érigée dans le courant qui ne revient pas.
Tu as réussi à m’arracher un à un ces fragments déchiquetés de mes temples.
Ne vide pas la bourse.
N’exhibe pas tes trophées.
Ne relate pas de nouveau tes prouesses de honteux gladiateur dans les galeries démesurées de l’écho.
Moi non plus je ne t’ai pas concédé une trêve.
J’ai violé tes statuts.
J’ai forcé tes serrures et je suis monté aux greniers qu’ils nomment avenir.
J’ai fait un seul brasier avec tous tes âges.
Je t’ai mise à l’envers comme un maléfice qui se bris
ou j’ai mélangé tes enceintes comme un anagramme dont les lettres
transforment l’ordre et changent le sens.
Je t’ai condensé jusqu’au point d’une bulle immobile,
opaque, prisonnière dans mes ciels vitreux.
J’ai étiré ta peau sèche dans des langues de mémoire,
jusqu’à ce que la perforent les pâles trous de l’oubli.
Un coup de dés l’a fait vaciller sur le vide immense entre deux heures.
Nous sommes arrivés loin dans ce jeu atroce, nous acculant l’âme.
Je sais qu’il n’y aura pas de repos,
et ne me tente pas, non, de me laisser envahir par l’ombre placide,
des végétaux centenaires,
bien qu’à la fin de tout, tu sois debout, en train de recevoir ta paie
le mesquin pot de vin que martèlent en ton honneur les rauques
machineries de la mort.
Et n’écris pas alors sur les frontières blanches “jamais plus”
avec ta main ignorante,
comme si quelque ieu de dieu,
un gardien antérieur, le maître de toi-même dans un autre toi qui comble les ténèbres.
Peut-être que tu es à peine l’ombre la plus infidèle d’un de ses chiens. »